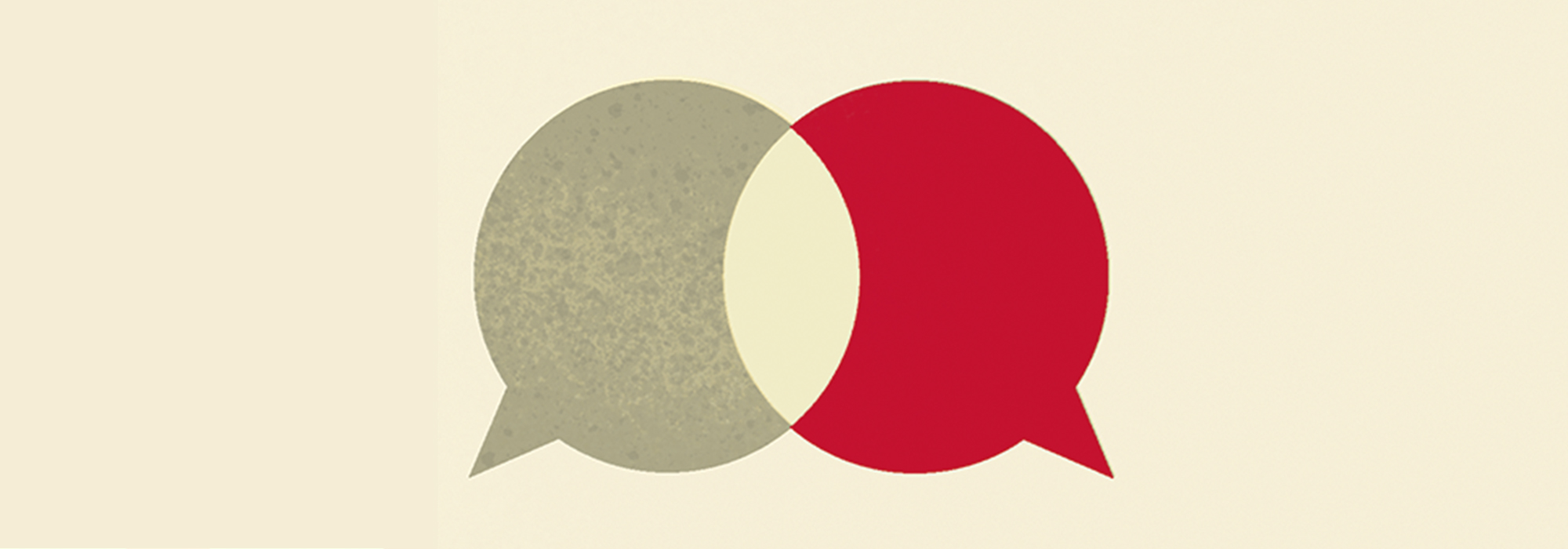La refonte de la Loi sur les langues officielles : une nouvelle vision du bilinguisme ?
La carte linguistique du Canada a changé. Le déclin du français se poursuit, à mesure que les immigrants et les francophones de souche, notamment à l’extérieur du Québec, se tournent vers l’anglais. Le projet de loi C-13 constitue une tentative courageuse de maîtriser cette nouvelle réalité. Cependant, comme ses prédécesseurs, le projet de loi demeure captif du passé, tributaire du principe de l’égalité des droits linguistiques, un droit individuel transportable. Une mouture plus robuste de la loi pour stopper le déclin du français, et ainsi créer une nouvelle vision du bilinguisme, inclurait la reconnaissance du rôle central du Québec dans la préservation du français au Canada, l’obligation d’harmoniser les lois linguistiques fédérales avec celles du Québec et, hors Québec, de donner plus de substance à la notion de « région à forte présence francophone » et d’instaurer des mesures fortes pour soutenir le français.
Introduction
Le projet de loi C-13 modifiant la Loi sur les langues officielles rompt avec le passé en inscrivant officiellement la protection et la promotion du français parmi ses objectifs explicites. Son titre abrégé, Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada, est un aveu tacite de l’inégalité des deux langues officielles du pays. La perception du bilinguisme au Canada, mais aussi de la place qu’y occupe le Québec, sont en train de changer.
En juin 2021, la Chambre des communes a massivement appuyé la motion du Bloc québécois appuyant le projet de loi 96 du Québec, qui reconnaît le droit de cette province de se définir comme nation et de faire du français sa seule langue officielle. Et voici maintenant que le projet de loi C-13 reconnaît officiellement la Charte de la langue française du Québec (aussi appelée loi 101), qui « dispose que le français est la langue officielle du Québec », s’éloignant manifestement de la vision du bilinguisme de Pierre Elliott Trudeau fondée sur le droit de tous les Canadiens d’apprendre et d’utiliser le français ou l’anglais.
Une première mouture du projet de loi fut présentée en juin 2021 (C-32), déposée presque au même moment que l’approbation de la motion du Bloc québécois. Cependant, le déclenchement des élections fédérales a empêché son adoption. Rebaptisé projet de loi C-13, il fut de nouveau présenté à la Chambre des communes avec quelques modifications le 1er mars 2022.
Le projet de loi 96 du Québec visant à renforcer la loi 101 et le projet de loi C-13 d’Ottawa modifiant la Loi sur les langues officielles reposent tous deux sur le même impératif politique : enrayer le déclin du français. De fait, ils sont essentiellement complémentaires. Un tour de force quand on pense à la condamnation quasi unanime de la loi 101 hors Québec et à l’hostilité presque viscérale des nationalistes québécois à l’égard du bilinguisme officiel, vu comme le cheval de Troie de l’anglicisation.
La carte linguistique du Canada a changé depuis la promulgation en 1969 de la Loi sur les langues officielles. L’équilibre démographique entre les deux langues est brisé. Pour rester officiellement bilingue, le Canada doit donc endiguer le recul du français ou bien redéfinir la notion même de bilinguisme. Le projet de loi C-13 est un effort courageux de composer avec cette nouvelle réalité.
La nouvelle mouture de la loi comporte plusieurs éléments qu’il faut applaudir, à commencer par la reconnaissance explicite des menaces qui pèsent sur le français et les nouveaux pouvoirs accordés au commissaire aux langues officielles, pour ce qui est notamment de l’obligation faite aux entreprises de compétence fédérale d’offrir des services bilingues. Air Canada est souvent cité comme exemple à cet égard. Saluons également la consigne donnée aux tribunaux d’interpréter libéralement les droits linguistiques en tenant compte des injustices passées, de même que l’introduction du concept de « régions à forte présence francophone » (RFPF), qui reconnaît implicitement que la vitalité d’une langue (en l’occurrence le français) est tributaire du contexte social et, par conséquent, liée à un territoire. Dans la même veine, le projet de loi C-13 réaffirme l’engagement du gouvernement de prendre des « mesures fortes » en faveur du français, plus particulièrement en matière de langue de travail dans des entreprises de compétence fédérale. Ottawa vise enfin l’accroissement de l’immigration francophone pour freiner le recul du français hors Québec. Autant d’avancées dont on doit se réjouir.
Mais comme les lois précédentes, ce projet de loi reste captif de son passé et tributaire du principe d’égalité des droits linguistiques, un droit individuel valable peu importe le territoire. Les droits linguistiques découlent presque toujours de compromis politiques. Le Canada n’y échappe pas. Le projet de loi tente vaillamment de concilier deux approches, l’une axée sur l’égalité des droits, l’autre sur le contexte social et le territoire. Elles ne sont pas nécessairement compatibles. L’application de « mesures fortes » pour véritablement protéger le français peut exiger de lui donner préséance sur l’anglais, ce qui déroge au principe d’égalité des droits. Un dilemme non résolu par le projet de loi C-13.
Une mise en garde s’impose avant d’aller plus loin : je ne suis pas juriste. Mon point de vue est celui d’un chercheur des sciences sociales avec une formation en sciences économiques et en démographie. La question que je pose ici est la suivante : le projet de loi C-13 réussira-t-il à arrêter le déclin du français au Canada ? Malheureusement, ma réponse est non, surtout pas hors Québec. Pour comprendre pourquoi j’en arrive à cette conclusion et les recommandations qui en découlent, nous allons dans un premier temps revisiter la loi originale et, dans un deuxième temps, réexaminer l’évolution du français au Québec et dans le reste du pays.
La Loi sur les langues officielles ne visait pas à sauver le français
La Loi sur les langues officielles a été adoptée en réaction à une menace existentielle pour le Canada. On peut difficilement imaginer aujourd’hui l’ampleur de la crise que traversait alors le pays. La section qui conclut le Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme de 1965, d’ailleurs intitulée « La crise », s’ouvre comme suit : « Tout ce que nous avons vu et entendu nous a convaincus que le Canada traverse la période la plus critique de son histoire, depuis la Confédération. […] Nous ignorons si cette crise sera longue ou brève. Nous sommes, toutefois, convaincus qu’elle existe. » Six pages plus loin, les commissaires concluent en ces termes : « Certains croient que les problèmes s’amenuiseront et disparaîtront avec le temps. C’est possible mais, à notre avis, il est plus probable que la situation ira en s’aggravant, à moins de réformes capitales, et qu’elle pourrait se détériorer beaucoup plus rapidement que beaucoup ne le croient ».
Pièce maîtresse des mesures promises par Pierre Elliott Trudeau pour dénouer la crise, la Loi sur les langues officielles allait être promulguée quatre ans plus tard. Entre-temps, les pires craintes des commissaires semblaient se réaliser. Le Front de libération du Québec posait des bombes dans les quartiers anglophones de Montréal. Et René Lévesque, charismatique ministre du gouvernement québécois, quittait en 1968 le Parti libéral du Québec pour fonder le Parti québécois, qui accéderait au pouvoir sept ans plus tard en promettant un référendum sur l’indépendance. En 1969, la séparation du Québec était une possibilité réelle.
Pourquoi ce voyage dans le passé ? Simplement pour rappeler que la loi de 1969 visait à convaincre les Québécois francophones que le Canada était aussi leur pays, et qu’ils pouvaient s’y sentir partout chez eux. Tout comme le gouvernement fédéral était leur gouvernement, désormais investi du mandat explicite de protéger leurs droits en tant que francophones.
Quelque 50 ans plus tard, on peut affirmer que Trudeau père a largement gagné son pari, en transformant littéralement le pays et sa perception de lui-même. L’Union Jack s’est effacé du drapeau du pays et selon un récent sondage Léger, environ 80 p. 100 des Québécois se disent fiers d’être Canadiens. En revanche, la loi n’a pas empêché la montée du sentiment national québécois ni le déclin du français hors Québec, deux phénomènes indissociables.
La loi ne visait pas à sauver le français. Aucune donnée ne semblait l’exiger à l’époque, le statut de la population francophone paraissant assuré. Le recensement de 1961 indiquait que 28 p. 100 des Canadiens étaient de langue maternelle française, plus ou moins la même proportion que 60 ans plus tôt. Depuis la Confédération, la population francophone du pays s’est maintenue autour de 30 p. 100. Bien sûr, elle se concentrait très majoritairement dans la seule province du Québec, mais il était essentiel de démontrer que le français serait dorénavant respecté partout au pays (le traitement peu glorieux réservé au français hors Québec était l’un des moteurs du séparatisme québécois).
Bref, la loi de 1969 se proposait de réparer une erreur historique en accordant enfin au français le respect et le statut juridique qui lui revenaient. Égalité juridique et réalité démographique sont toutefois deux choses différentes. Les auteurs de la loi originale ne pouvaient prévoir l’évolution du rapport entre les deux langues. Or, il a changé (voir figure 1) : le pourcentage des Canadiens de langue maternelle française a systématiquement diminué depuis 1961 et tombera vraisemblablement sous la barre des 20 p. 100 bientôt, si ce n’est déjà fait.
Rupture de l’équilibre linguistique
Comment expliquer ce rapide déclin ? La première raison en est très simple : moins d’enfants sont nés de mères francophones (voir la figure 1A de l’annexe). La Révolution tranquille des années 1960 au Québec a transformé le Canada français dans son ensemble, et l’Église catholique s’est vu retirer la gestion de l’éducation au Québec. Jadis une quasi-théocratie, le Québec allait devenir l’une des sociétés les plus sécularisées du monde occidental.
Conséquence inévitable de cette sécularisation, la baisse de la natalité a rompu le fragile équilibre démographique entre anglophones et francophones. Pour le dire sans détour, le Canada français faisait des enfants tandis que le Canada anglais accueillait des immigrants. Le taux de fécondité des femmes canadiennes-françaises est resté l’un des plus élevés d’Occident jusqu’à la fin des années 1950, ce qui compensait l’arrivée d’immigrants anglophones et anglicisés. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, la politique d’immigration canadienne a ouvertement privilégié les peuples anglophones et « nordiques ». C’est cet équilibre précaire qui s’est rompu lorsque les familles canadiennes-françaises ont cessé d’avoir autant d’enfants, alors que le Canada anglais continuait d’accueillir des immigrants. La suite était mathématiquement inéluctable.
On ne peut évidemment reprocher à la Loi sur les langues officielles de n’avoir pu prévenir la chute de la natalité, celle-ci étant notoirement insensible aux mesures politiques. Mais il en va autrement des choix linguistiques des immigrants (et des Canadiens de naissance) qui sont intimement liés aux politiques publiques, notamment en matière de langue d’enseignement et de travail. Ce qui nous amène à la deuxième raison du déclin du français : les transferts linguistiques, qui continuent de favoriser l’anglais, surtout hors Québec. Le Québec a eu tôt fait d’adopter des mesures visant expressément à freiner les transferts vers l’anglais, mais sans contrepartie dans le reste du pays, que ce soit au niveau fédéral ou provincial. Quelque 50 ans plus tard, c’est en quelque sorte à cette carence que le projet de loi C-13 souhaite remédier, au moins en partie. Un lourd défi dont on peut mesurer l’ampleur en regardant maintenant l’évolution contrastée du français au Québec et dans le reste du Canada (ROC).
La loi 101 : rétablir l’équilibre
La rupture de l’équilibre linguistique a transformé la vie politique québécoise. La question de la langue devient un enjeu crucial lors des élections de 1970, 1973 et 1976, et sera sans doute la raison principale de l’arrivée au pouvoir du Parti québécois en 1976. Devenus des vedettes médiatiques, des démographes prédisent sombrement que la proportion de francophones baissera bientôt sous les 70 p. 100 au Québec si rien n’est fait pour intégrer les futurs immigrants à la majorité linguistique. Même les immigrants de langues latines, notamment les Italiens, choisissent de plus en plus d’inscrire leurs enfants à l’école anglaise. Les données sont claires : le recensement de 1971 (le premier comprenant des statistiques sur la « langue parlée le plus souvent à la maison ») révèle qu’environ 90 p. 100 des immigrants deviennent anglophones après deux ou trois générations. Il fallait absolument agir.
C’est pour contrer ce déséquilibre démographique que le gouvernement du Parti québécois a fait adopter la loi 101 en 1977. Et il a gagné son pari. Le cataclysme redouté par les démographes n’a pas eu lieu (voir figure 2). Non sans paradoxe, la loi 101 a sans doute fait plus que toute autre mesure pour sceller l’échec du référendum québécois de 1980. Presque du jour au lendemain, l’argument voulant que seule l’indépendance assurerait l’avenir du français avait perdu sa force. En faisant désormais du français la langue de l’enseignement primaire et secondaire des futurs enfants d’immigrants, la loi 101 assurait qu’ils deviendraient des Québécois francophones (tout comme leurs descendants), ce qui était bel et bien l’objectif. Le visage du Québec français en fut changé à jamais.
Hors Québec : Un contexte différent
Il n’existe pas de législation comparable à la loi 101 hors Québec. Les immigrants n’y sont pas tenus de faire instruire leurs enfants en français. Qui plus est, les immigrants n’ont pas le droit automatique, selon l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, d’inscrire leurs enfants dans des écoles de la langue minoritaire, soit le français. Ce droit est réservé aux citoyens canadiens francophones hors Québec. Cependant, le fait de disposer d’un droit ne signifie pas nécessairement qu’on puisse ou veuille l’exercer. Cela dépend en grande partie du contexte social.
La figure 3 indique la langue officielle parlée à la maison dans les ménages où l’on parle aussi une autre langue que le français ou l’anglais. Sans mesurer comme telle la direction des transferts linguistiques, elle en donne une bonne idée. Les données parlent d’elles-mêmes : la quasi-totalité des ménages allophones hors Québec choisit l’anglais, à la seule exception du Nouveau-Brunswick, où environ 9 p. 100 de ces ménages choisissent le français, une proportion qui demeure bien inférieure aux 31 p. 100 de Néo-Brunswickois de langue maternelle française.
En somme, l’immigration a presque partout pour effet de faire chuter la proportion de francophones. Même au Québec, entre le quart et le tiers des immigrants allophones (selon la source et la cohorte) adoptent encore aujourd’hui l’anglais à la maison.
L’autre volet de la réalité francophone hors Québec est l’abandon de la langue. La figure 4 indique la proportion de francophones et d’anglophones (langue maternelle) dont la langue maternelle est encore leur langue d’usage à la maison. En montrant la propension d’un groupe à conserver sa langue (ou, inversement, à l’abandonner) et aussi sa capacité à attirer de nouveaux locuteurs, cette proportion illustre de façon simple la force d’attraction d’une langue. Nous pouvons raisonnablement supposer que les personnes qui parlent à la maison une autre langue que leur langue maternelle sont en voie de l’abandonner.
Ailleurs qu’au Québec et au Nouveau-Brunswick, la proportion de francophones ayant cessé de parler leur langue maternelle à la maison varie de 44 p. 100 en Ontario à 71 p. 100 en Colombie-Britannique. Même au Nouveau-Brunswick, environ 11 p. 100 des Acadiens ont renoncé à leur langue maternelle. Le Québec est la seule province où les francophones ne perdent pas leur langue (sauf dans d’infimes proportions). On pourra s’étonner de la proportion élevée pour l’anglais à Montréal, mais elle est caractéristique des centres urbains à forte concentration d’immigrants (allophones) et vient confirmer la force d’attraction de l’anglais dans la métropole québécoise.
La figure 5 illustre l’inévitable conséquence, hors Québec, du transfert continu vers l’anglais des immigrants et Canadiens de naissance. Non seulement la part des Canadiens de langue maternelle française hors Québec poursuit sa descente (moins de 4 p. 100 aujourd’hui), mais ils sont presque deux fois moins nombreux à toujours parler français à la maison (2,3 p. 100 de la population hors Québec), selon le recensement de 2016. Les deux variables se renforcent mutuellement. Si d’une génération à l’autre environ la moitié des francophones abandonnent leur langue, la courbe de la langue maternelle décroîtra inéluctablement, jusqu’à tomber à zéro.
La comparaison des figures 5 et 2 n’a rien d’encourageant. Toutes deux indiquent une baisse dans le poids des francophones (langue maternelle), un recul partiellement compensé au Québec par des non-francophones ayant adopté le français. Mais ce mécanisme compensatoire n’existe pas à l’extérieur du Québec. Si bien que la population francophone du Canada (qui parle français à la maison) se concentre de plus en plus au Québec. La progression des personnes parlant le français à la maison est quasi exclusivement attribuable à cette province (voir figure 2A de l’annexe). De 2001 à 2016, le Canada s’est ainsi enrichi de 590 075 francophones, dont seulement 5 640 (moins de 1 p. 100) hors Québec.
Deux minorités inégales
C’est au chapitre du français au travail que le contraste entre le Québec et le reste du pays est le plus frappant. Environ 80 p. 100 des Québécois travaillent principalement en français, une situation largement attribuable à la loi 101, qui impose des obligations linguistiques aux entreprises de 50 employés et plus, seuil que le projet de loi 96 propose d’abaisser à 25.
Répétons-le : il n’existe pas de législation équivalente dans les autres provinces. Sans surprise, seule une infime proportion de travailleurs (1,4 p. 100) y travaillent surtout en français, à peine davantage (2 p. 100) en incluant les milieux de travail bilingues. Même à Ottawa, qui compte la plus grande population francophone hors Québec et une forte présence du gouvernement fédéral, moins de 5 p. 100 des travailleurs déclarent travailler surtout en français (8 p. 100 en incluant les milieux de travail bilingues ; voir tableau 1A). Le tiers des francophones de la capitale nationale ont abandonné leur langue. Comparons cela à Montréal où 27 p. 100 des travailleurs disent travailler surtout en anglais et où les anglophones continuent d’accroître leurs rangs (voir figure 4). La différence n’est pas difficile à comprendre : les anglophones du Québec parlent une langue plus utile que les francophones dans le reste du pays, deux minorités linguistiques, en somme, très différentes.
Je ne peux m’empêcher de citer cet aphorisme d’Aristote : « La plus grande injustice est de traiter également des choses inégales. » Mettre la minorité anglophone du Québec et celle francophone hors Québec sur un même pied d’égalité a toujours irrité les Québécois, en les opposant inutilement aux francophones dans le reste du Canada. Il s’agit bel et bien de deux minorités, mais la langue de la minorité linguistique au Québec jouit d’un pouvoir d’attraction incomparable, une minorité démographique certes, mais aussi une majorité sociologique, pour employer le jargon des sociologues. La figure 6 illustre l’évolution récente des deux populations minoritaires. Non seulement le nombre de Québécois qui parlent anglais à la maison dépasse aujourd’hui le total des francophones hors Québec, mais leur nombre augmente plus rapidement. Si la tendance se maintient, c’est la minorité anglophone du Québec qui deviendra la principale bénéficiaire de la générosité d’Ottawa, un revirement de situation pour le moins ironique considérant l’objectif initial des lois linguistiques au pays.
La montée de l’anglais
L’arrivée presque au même moment du projet de loi C-13 à Ottawa et du projet de loi 96 à Québec n’est pas qu’affaire de statistiques. Que la langue française soit menacée est une réalité quotidienne pour la grande majorité des francophones. Près d’un demi-siècle après la loi 101, il est toujours possible (et aucunement inhabituel) de vivre en anglais à Montréal et d’y gravir les échelons de l’industrie sans parler français. Tout récemment, le PDG d’Air Canada a déclenché une petite tempête médiatique en novembre 2021 en déclarant, lors d’un discours prononcé en anglais seulement devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qu’il avait vécu 14 ans à Montréal sans apprendre le français, ajoutant que les Montréalais devraient s’enorgueillir qu’on puisse réussir dans leur ville en anglais.
L’inégalité entre les deux langues s’est accentuée. La perception selon laquelle le français perd du terrain ne cesse de s’amplifier depuis 25 ans (voir figure 7). Inutile d’en chercher bien loin la raison : la progression fulgurante de l’anglais dans un monde globalisé et informatisé. L’univers numérique avait besoin d’une langue commune, et ce fut l’anglais. Il s’est tout naturellement imposé comme la lingua franca planétaire, à la fois comme langue des sciences, des affaires et du spectacle, et comme langue commune de l’Europe et de l’Asie. L’époque où le français était la langue première de la diplomatie internationale est révolue.
La culture française a cessé d’être la référence des intellectuels en herbe de New York ou de Rio, menacée même sur son propre territoire. Un sondage récemment mené auprès des francophones du Québec a révélé qu’à peine 9 p. 100 des jeunes de 15 à 35 ans écoutaient de la musique francophone, contre la moitié des plus de 55 ans. Il n’y a pas que la chanson. Dans tous les domaines (télé, théâtre, magazines, etc.), ces jeunes consommaient proportionnellement moins de produits culturels francophones que leurs aînés. Pour réussir aujourd’hui dans le monde des sciences et des technologies, tous les étudiants savent qu’ils doivent maîtriser l’anglais, langue des technologies de l’information, des congrès scientifiques internationaux et des plus prestigieuses revues scientifiques.
Le français reste l’une des grandes langues du monde, mais il n’est plus un concurrent de taille face à l’anglais. Trois conclusions découlent de notre voyage au Québec et à l’extérieur de ses frontières :
- Seules des mesures législatives robustes peuvent contrer l’attrait grandissant de l’anglais — en effet, même la loi 101 n’y suffit plus ;
- On ne peut comparer la situation des anglophones du Québec et des francophones du reste du pays puisque les premiers parlent la langue plus utile ;
- Pour favoriser la survie et l’épanouissement du français hors Québec, il faut miser en priorité sur des régions où les francophones forment déjà une solide majorité.
En introduisant le concept de régions à forte présence francophone (RFPF), le projet de loi C-13 reconnaît implicitement cette réalité territoriale, même si sa définition reste très ouverte. Parmi les principales « mesures fortes » promises en faveur du français se trouvent la promotion de l’immigration francophone et le renforcement du droit de travailler en français. Examinons alors plus en détail la présence du français hors Québec.
Second regard sur le français hors Québec
La situation du français hors Québec, telle que présentée jusqu’ici, n’est guère réjouissante. Le recensement de 2016 découpe le Canada en 288 divisions de recensement, dont 190 hors Québec. La figure 8 présente les 11 divisions où la proportion des francophones (langue maternelle) qui parlent toujours le français à la maison est supérieure à 70 p. 100, seuil minimal en dessous duquel la survie de la langue devient de facto impossible, quoique cette limite soit sûrement fort indulgente, vu la force d’attraction de l’anglais.
La figure 8 offre des bonnes et des mauvaises nouvelles. Commençons par les bonnes : plus de 300 000 francophones vivent dans des divisions de recensement où la persistance du français reste forte. Elles regroupent le tiers des francophones hors Québec, la moitié si l’on compte uniquement ceux qui parlent français à la maison.
La survie du français dépend beaucoup des circonstances locales. Les Québécois aiment bien s’identifier aux irréductibles Gaulois (d’après la célèbre bande dessinée Astérix) défendant vaillamment leur territoire dans un océan anglophone. Mais les véritables Gaulois seraient plutôt les Acadiens, qui ont résisté dans des conditions bien plus ardues. Neuf des 11 divisions de recensement de la figure 8 sont acadiennes. Les deux autres, Prescott-Russell et Cochrane, correspondent également à des zones particulières : la première forme une bande de villes ontariennes largement francophones au sud de la rivière des Outaouais entre Montréal et Ottawa, la seconde jouxte également le Québec et se concentre autour d’un corridor longeant la route 11 dans le Nord de l’Ontario.
L’exploit linguistique de l’Acadie (du moins par rapport au reste du Canada français hors Québec) confirme aussi l’importance des politiques publiques. Les cinq premières divisions, où le taux de rétention linguistique est supérieur à 90 p. 100, se trouvent toutes au Nouveau-Brunswick. Seule province officiellement bilingue du pays, celle-ci offre une gamme complète de services publics en français et abrite la seule grande université de langue française hors Québec, soit l’Université de Moncton et ses trois campus de Moncton, Edmundston et Shippagan. Ces deux derniers se trouvent respectivement dans le Madawaska et sur la Péninsule acadienne, qui sont aussi les deux seules divisions où plus de la moitié des travailleurs travaillent en français.
Hors du Nouveau-Brunswick, les deux bastions acadiens de Digby et Inverness, en Nouvelle-Écosse, témoignent en outre de l’importance du sentiment d’identité. Bien plus qu’une simple région, l’Acadie évoque une identité dont les racines historiques transcendent les frontières provinciales. Les Acadiens diffèrent ainsi des francophones à l’ouest du Québec, qui s’identifient généralement à leurs provinces respectives. La géographie a aussi son importance, la proximité avec le Québec offrant un avantage évident. Ainsi, Madawaska et Prescott-Russell constituent en quelque sorte des prolongements démographiques du Québec. Voilà pour les bonnes nouvelles sur la francophonie hors Québec, passons maintenant aux mauvaises.
L’absence d’ancrage urbain
La majorité des francophones hors Québec vivent dans des milieux massivement anglophones. Le Canada est une nation urbaine. Or, à l’exception de Moncton (comté de Westmorland), la figure 8 ne compte aucun centre urbain d’importance ; même la région métropolitaine de recensement (RMR) de Moncton est majoritairement anglophone (60 p. 100 pour la langue maternelle et 67 p. 100 pour la langue parlée à la maison). Hors Québec, le Canada français ne compte aucun centre urbain qui représenterait une « métropole » à laquelle s’identifier et où les immigrants (et les migrants internes) seraient naturellement portés à adopter le français comme langue d’usage. On n’y trouve donc aucun équivalent des RMR majoritairement francophones du Québec.
Le tableau 2A de l’annexe énumère les 19 principales RMR hors Québec, villes où vivent les deux tiers des Canadiens à l’extérieur de cette province. Un quart de million de francophones vivent dans ces milieux urbains, dont 38 p. 100 parlent toujours français à la maison. Prenons Toronto comme exemple. Les francophones y sont en infime minorité (1,1 p. 100 de la population). Et moins de 1 p. 100 de la main-d’œuvre y travaille en milieu français ou bilingue. À peine 10 p. 100 des Torontois comprennent le français. Nul besoin d’être statisticien pour en conclure que Toronto et ses villes sœurs sont peu propices à la vie en français.
En corollaire de cette absence d’ancrage urbain, les collectivités francophones hors Québec les plus fortes (pouvant donc prétendre à la désignation RFPF) sont souvent des petites localités rurales situées en périphérie, affichant des soldes migratoires négatifs. Y renforcer le français serait évidemment une bonne chose, mais cela ne changera pas grand-chose au déclin généralisé du français hors Québec.
Des solutions peu efficaces (et incomplètes)
Trois conclusions s’ensuivent. Premièrement, l’immigration francophone, quoique certainement la bienvenue, aura peu impact sur le déclin du français hors Québec. S’il est une chose que la loi 101 nous apprend, c’est que les immigrants et leurs descendants (francophones compris) adopteront souvent l’anglais comme langue de vie, même dans les centres urbains majoritairement francophones comme Montréal, à moins d’être contraints de faire autrement. À leur arrivée à Toronto, de nombreux parents haïtiens ou sénégalais, peut-être la majorité, choisiront sans doute d’inscrire leurs enfants à l’école anglaise. Ils sont libres de le faire. D’autant que l’article 23 de la Charte, nous l’avons vu, leur interdit en principe l’accès au système français jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur citoyenneté. Leurs descendants adopteront donc en majorité l’anglais comme langue première, à l’exemple des autres francophones (langue maternelle) de Toronto. En attirant les immigrants francophones vers les centres urbains hors Québec, on créera tout au plus l’illusion d’un essor temporaire du français, sauf peut-être à Ottawa et Moncton (et même là, on peut en douter).
L’idée d’attirer des immigrants francophones dans des petits centres urbains et des zones rurales « à forte présence francophone » se défend beaucoup mieux, pour autant qu’on puisse les convaincre de s’y établir durablement, ce qui est un défi en soi. Leur nombre sera forcément restreint. Cependant, leurs descendants, établis à Shippagan par exemple risquent fort de quitter cette ville de la Péninsule acadienne pour s’installer dans un grand centre urbain, comme leurs confrères acadiens de souche. Bien entendu, il n’en faut pas moins soutenir les institutions francophones (hôpitaux, conseils scolaires, etc.) ou les entreprises locales qui souhaitent embaucher des immigrants francophones, mais cela ne modifiera pas fondamentalement les réalités économiques de la région. Ce n’est pas leur fonction.
Deuxièmement, s’il est tout aussi souhaitable de soutenir des institutions francophones locales (écoles, centres culturels, etc.), cet appui ne signifie pas nécessairement qu’il est possible de réellement vivre en français dans la communauté, surtout hors des RFPF. La plupart des francophones hors Québec vivent, nous l’avons vu, dans des collectivités qu’il serait difficile de désigner comme RFPF — où la présence du français est suffisamment forte pour qu’il soit effectivement la langue du quotidien et du travail. Nous tirerions certainement une différente conclusion sur cet aspect si nous pouvions faire la démonstration, modèles statistiques à l’appui, que l’aide fédérale aux institutions locales a effectivement freiné le déclin du français dans les régions francophones en situation minoritaire. Malheureusement, les données ne nous autorisent pas à faire un tel lien. Or, ce soutien ne devrait peut-être pas être l’objectif des interventions fédérales en milieu francophone hors RFPF.
Il va de soi que la vitalité des collectivités minoritaires passe par le financement adéquat d’institutions locales, notamment les écoles, dirigées et gérées par des francophones. Les minorités francophones de Whitehorse ou de Vancouver ne devraient pas avoir à justifier leur droit d’avoir des écoles. Mais on ne doit pas leur demander l’impossible, c’est-à-dire modifier la dynamique démographique de leurs communautés, villes ou régions. Pouvoir s’instruire en français à Vancouver n’assure pas qu’on pourra y vivre et y travailler en français après avoir quitté les bancs d’école. Ne mêlons pas les deux objectifs.
Troisièmement, le renforcement du droit de travailler et d’être servi en français (peut-être le volet le plus fort du projet de loi C-13, qui s’accompagne comme nous l’avons vu des nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles) n’assure pas pour autant que le français deviendra effectivement la langue de travail et des communications internes des entreprises de compétence fédérale des RFPF ou d’autres milieux francophones minoritaires.
Nous arrivons ici à ce que j’appelle le péché originel du projet de loi, évoqué en introduction : l’égalité des droits comme principe directeur. Les droits linguistiques diffèrent d’autres droits, car ils sont de nature sociale par définition, et inopérants si la langue en cause n’est pas aussi comprise et employée par d’autres. Nous avons vu qu’on peut disposer d’un droit en matière d’éducation sans nécessairement l’exercer. Le contexte social y joue pour beaucoup. C’est encore plus vrai pour la langue de travail, où deux droits se retrouvent de facto en concurrence dans le même bureau ou sur le même plancher d’usine. Comme le savent d’expérience beaucoup de francophones, le droit égal de travailler en anglais ou en français se traduit plus souvent qu’autrement par l’utilisation comme langue commune de la langue maîtrisée par le plus grand nombre, c’est-à-dire l’anglais.
Le projet de loi C-13 : a) réaffirme le droit (des employés) d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français, notamment dans les entreprises de compétence fédérale des RFPF ; b) ajoute des protections pour les travailleurs qui ne parlent pas anglais ; c) exige des entreprises qu’elles établissent des comités internes qui appuieront la haute direction dans sa prise de mesures en faveur du français. S’il s’agit à nouveau de mesures positives qu’il faut applaudir, elles n’interdisent pas le droit parallèle de travailler en anglais. En excluant la possibilité d’imposer parfois le français comme langue commune de travail (pour tous), le projet de loi C-13 transfère de fait la responsabilité de la mise en œuvre de ce droit aux travailleurs (ou à leurs syndicats), tout comme les moutures précédentes de la loi. Les salariés disposent certes maintenant de recours judiciaires plus puissants, mais cela ne change rien aux réalités interpersonnelles sur le terrain, que ce soit au bureau ou dans l’usine. Du moins, c’est la lecture que j’en fais.
Bref, le droit de travailler en français reste limité à moins que tous les intéressés (ou la grande majorité d’entre eux) ne comprennent et n’emploient vraiment cette langue, ce qui implique nécessairement de restreindre l’anglais. Le Québec offre à nouveau un point de référence utile à cet égard. Si l’on compare les salariés des administrations publiques québécoise et fédérale, on voit que 1 p. 100 travaillent surtout en anglais dans la première par rapport à 29 p. 100 dans la seconde. Au sein du secteur privé québécois, cette proportion est de 12 p. 100. Contrairement aux salariés du secteur privé québécois, ceux des institutions fédérales ont en effet le droit de travailler en français ou en anglais, conformément à l’esprit de la Loi sur les langues officielles.
Le dilemme linguistique canadien
L’imbroglio linguistique canadien est un cas classique de conflit d’objectifs. Ottawa ne peut à la fois traiter les deux langues de façon égale et arrêter le déclin du français. Le projet de loi C-13 se trouve devant un dilemme. Cela explique en bonne partie son effort (que j’applaudis) de définir très libéralement la notion d’« égalité réelle », comme nous l’avons vu en introduction, mais aussi son incapacité à franchir le pas décisif en affirmant qu’on peut dans certains cas donner priorité à une langue (en l’occurrence le français).
Les origines du dilemme se trouvent dans l’histoire du peuplement européen du pays et dans les impératifs politiques des années 1960, au moment de l’adoption de la Loi sur les langues officielles. Si Pierre Elliott Trudeau avait été démographe (ou sociologue) plutôt que professeur de droit, la loi aurait sans doute été rédigée bien différemment. Elle avait pour but, nous l’avons vu, de protéger des droits individuels, transportables à travers le pays. La mobilité géographique est au cœur de l’histoire du Canada. Dès leur arrivée sur le continent, les premiers colons français ont sillonné le territoire : coureurs de bois, voyageurs et Métis furent les acteurs clés de la saga de la colonisation de l’Ouest. Comme pour prolonger cet idéal de mobilité dans le monde moderne, la loi a consacré le droit de tous les Canadiens à des services dans les deux langues, peu importe l’endroit où ils choisissent de s’établir.
Et la crise de l’unité nationale dictait la nécessité d’appliquer uniformément les droits linguistiques dans toutes des provinces, sans distinction. Pierre Elliott Trudeau s’opposait à toute forme de statut particulier pour le Québec. Les anglophones de la province auraient droit à des services dans leur langue, tout comme les francophones du reste du pays dans la leur.
Cette conception du bilinguisme et des droits linguistiques diffère de celle de la plupart des pays occidentaux bilingues (ou multilingues), la Suisse et la Belgique notamment. Chaque groupe linguistique y bénéficie de ses propres espaces protégés (régions, cantons, etc.) pour assurer la paix sociale. Ainsi, les lois suisses et belges visent plutôt à restreindre les points de rencontre et de concurrence entre les langues.
Cette vision européenne découle de la consolidation des frontières linguistiques sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Le Canada est aujourd’hui engagé dans la même voie. Au Québec, l’anglais a pour ainsi dire disparu des petites villes à l’extérieur de Montréal. Je me souviens du temps où la ville de Québec abritait une communauté anglophone importante, qui possédait son propre quotidien. Un lointain souvenir. Le français subit aujourd’hui le même sort dans maintes régions du Canada d’abord colonisées par des francophones. Dans les villes minières du Nord et les champs de pétrole albertains, de nouveaux arrivants — souvent des Québécois — pourront susciter un essor temporaire de la population francophone et de la demande correspondante de services en français. Mais il s’agit justement de situations provisoires qui n’engendreront pas une vie française pérenne.
Il faut bien sûr protéger les droits (individuels) des francophones partout au pays, mais la protection linguistique des collectivités francophones historiquement fortes contre l’irrésistible invasion de l’anglais relève d’un type de droit différent. Existe-t-il une porte de sortie pour résoudre ce dilemme ? L’héritage canadien d’égalité des droits (admirable à plusieurs égards) est-il vraiment incompatible avec la protection de collectivités linguistiques ? Pas nécessairement. Je crois que nous nous orientons vers un modèle hybride spécifiquement canadien de bilinguisme, un jeu d’équilibre avec lequel le Québec essaie de composer depuis l’adoption de la loi 101, en imposant le français tout en respectant certains droits fondamentaux de sa minorité anglophone.
Si la Cour suprême du Canada a invalidé (ou affaibli) certains volets de la loi 101, elle en a toutefois validé l’architecture centrale, reconnaissant implicitement que les droits linguistiques des anglophones (en matière d’instruction, d’avis publics, de travail, etc.) peuvent varier entre les provinces et que le français, la plus faible des deux langues, mérite des protections spéciales.
Le même raisonnement ne peut-il pas aussi s’appliquer à l’intérieur des provinces ? Le principal obstacle à la mise en œuvre des mesures fortes en faveur du français hors Québec n’est pas, en somme, de nature juridique mais politique. C’est ici que le projet de loi C-13 déçoit. Il aurait pu aller plus loin en ouvrant la voie à une vision renouvelée du bilinguisme : celle d’un Canada fort de deux langues officielles, chacune ayant droit à des espaces protégés, tout en restant fidèle à l’idéal fondateur de respect des deux langues partout au pays.
Redéfinir le bilinguisme
Un projet de loi C-13 remanié pourrait inclure les dispositions suivantes :
- Reconnaissance du rôle central du Québec dans la préservation du français au Canada. Si nous parvenons, comme il faut l’espérer, à empêcher le déclin du français au-dessous d’un seuil politiquement intenable, ce sera grâce à la force continue du français au Québec. C’est la première condition pour assurer la survie du bilinguisme, sans laquelle la seconde — maintenir des collectivités francophones viables hors Québec — deviendra impossible.
- Obligation d’harmoniser les lois linguistiques fédérales avec celles du Québec, notamment en matière de langue de travail. Peu importe que cette harmonisation prenne la forme de lois fédérales parallèles (la voie que semble privilégier le projet de loi C-13, même si les amendements proposés restent en deçà de la loi 101) ou qu’on soumette les institutions de compétence fédérale aux lois québécoises, il s’agit ici d’assurer leur compatibilité.
- Reconnaissance du rôle particulier de l’Acadie dans la préservation du français au Canada. Plusieurs avenues sont envisageables, à commencer par la désignation d’une « zone prioritaire francophone » définie en collaboration avec les gouvernements provinciaux et les communautés acadiennes. Je pense aussi à un financement ciblé pour les entreprises et les établissements d’enseignement postsecondaires acadiens, coordonné possiblement par un organisme fédéral attitré.
- Attribution de plus de force au concept de « régions à forte présence francophone », qu’on pourrait peut-être rebaptiser « zones prioritaires francophones », ou autre appellation du genre, pour insister sur la priorité accordée au français. La modification viserait : a) à préciser les critères de désignation ; b) à clarifier les mesures de protection du français que soutiendrait Ottawa de concert avec les gouvernements locaux et provinciaux, dont la création ou le renforcement d’établissements d’enseignement postsecondaire.
J’ai déjà proposé ailleurs une approche par le bas par laquelle les autorités locales (municipalités, comtés, etc.) pourraient demander une telle désignation qui leur donnerait accès à des fonds fédéraux, conditionnels à l’adoption de règlements visant à promouvoir le français dans les milieux de travail, l’éducation, la signalisation, etc. Cela présuppose toutefois l’existence de lois provinciales donnant les pouvoirs nécessaires aux autorités locales. - Promotion du français comme langue commune de travail dans des lieux de travail fédéraux et de compétence fédérale des RFPF. Il s’agirait plus précisément de l’obligation de faire du français la langue de travail des institutions fédérales dans des localités (municipalités, comtés, etc.) comptant une population francophone supérieure à 50 p. 100.
- Désignation d’Ottawa comme « zone prioritaire francophone » spéciale, avec l’engagement sur cinq ans d’assurer qu’un quart des effectifs fédéraux travaillent dans des unités où la langue de travail est le français, situées idéalement dans le centre-ville d’Ottawa.
- Promotion d’un dialogue sur la sécurité linguistique. Le Canada devrait-il s’inspirer de la Suisse ? Faut-il privilégier, dans certains cas, les droits linguistiques collectifs plutôt qu’individuels ? La loi 101 a créé un précédent pour les immigrants. Les résidents du Québec qui n’ont pas fait leur scolarisation primaire au Canada ne peuvent faire instruire leurs enfants en anglais. Cette restriction serait-elle également justifiée dans certaines RFPF ? La question n’est pas sans importance étant donné l’intérêt du gouvernement pour l’immigration francophone.
En poussant un plus loin l’exemple de la Suisse, pourrait-on imaginer que dans certaines RFPF, l’enseignement en français soit obligatoire pour tous les nouveaux arrivants ? La première version de la loi 101 comportait une telle disposition (limitant l’accès à l’école anglaise aux seuls enfants de parents scolarisés en anglais au Québec), que la Cour suprême a invalidée en remplaçant le mot « Québec » par « Canada ». Sa décision serait sans doute confirmée aujourd’hui. Mais qu’en sera-t-il demain, si l’immigration intérieure du reste du Canada vers le Québec augmentait ? - Introduction de la notion de minorité (ou majorité) sociologique. L’interprétation du concept d’« égalité réelle » doit être bonifiée. L’égalité véritable adviendra le jour où francophones et anglophones se sentiront égaux dans leur capacité à la fois de garder leur langue (à savoir, la transmettre à de futures générations) et d’attirer de nouveaux locuteurs. Ce jour-là, on pourra parler d’égalité au sens sociologique du terme, un objectif probablement inatteignable.
En ce sens, il faut reconnaître formellement l’inégalité des minorités francophones et anglophones du pays. Comme avenue possible, je propose : a) d’ajouter l’adjectif « sociologique » à «minorité » ; et b) de ne plus traiter la minorité anglophone comme un groupe monolithique. Comme nous l’avons vu, un groupe peut former une minorité démographique mais être en même temps une majorité sociologique (et inversement). Dans toutes les divisions de recensement hors Québec, sauf le Madawaska (au Nouveau-Brunswick), les populations francophones forment des minorités à la fois sociologiques et (le plus souvent) démographiques. Dans 68 des 98 divisions du Québec, les populations anglophones sont aussi des minorités sociologiques, principalement concentrées dans l’est de la province. Mais dans les 30 autres divisions, les minorités anglophones sont des majorités sociologiques (qui attirent d’autres populations) concentrées dans le Grand Montréal et l’ouest de la province. Le premier groupe mérite en principe d’être traité « à égalité » avec les minorités francophones, une proposition toutefois contestable pour le second.
Rappel à la réalité politique
Si nous avons surtout parlé de l’avenir du français hors Québec, c’est parce qu’il s’agit du principal défi à relever, mais aussi parce que c’est là où le projet de loi C-13 manque de courage. On ne devrait toutefois pas s’en étonner. C-13 s’adresse avant tout au Québec, où vivent 90 p. 100 des francophones du pays. Cela changera peut-être sous le mandat d’une ministre responsable acadienne (Ginette Petitpas Taylor). À vrai dire, le projet de loi ne devait pas faire grande-chose pour plaire au Québec. Il lui suffisait de s’engager à respecter la loi 101 et à inscrire la protection du français comme objectif clé.
C-13 remplit en gros les deux conditions, même si les amendements visant l’harmonisation avec la loi 101 nécessiteront des modifications pour les rendre conformes. Ces modifications ne sont pas trop complexes, autant symboliques que substantiels ; ce qui n’en réduit nullement la portée. Promettre l’harmonisation de la législation fédérale avec la loi 101 et accorder au français une place prioritaire marque, nous l’avons dit, une rupture avec le passé. D’où cette question : pourquoi le reste du Canada est-il d’accord avec ce virage ? J’estime qu’une bonne partie de la classe politique du ROC est arrivée à la conclusion qu’un bilinguisme qui ne fait qu’aliéner des Québécois est en fin de compte contre-productif. De plus, une bonne partie du ROC n’a jamais pleinement adhéré à la noble vision du bilinguisme pancanadien de Trudeau père.
Quelles que soient les motivations politiques qui sous-tendent le projet de loi C-13, il aura atteint son objectif s’il parvient à modifier la perception des Québécois à l’égard d’Ottawa, désormais un allié dans la lutte pour la sécurité linguistique. Ce ne serait pas un mince exploit.
Malheureusement, C-13 ne promet pas une sécurité comparable aux francophones hors Québec. N’ayons pas peur de le répéter : il reste fidèle à une philosophie visant à protéger les droits linguistiques individuels, ce qu’il fait remarquablement, mais on ne saurait confondre cette protection avec celle des collectivités linguistiques. Dans un monde où la croissance démographique naturelle (naissances par rapport aux décès) est insuffisante, la croissance future reposera désormais sur l’intégration de nouveaux arrivants ; ce qui nécessitera non plus de seulement protéger le français mais de l’imposer, éventualité hautement improbable hors Québec dans un avenir prévisible.
Mais évitons de reprocher au projet de loi C-13 ce qu’il ne peut faire. Même si Ottawa soutenait plus fermement le français hors Québec, avec toutes les mesures fortes promises, l’effet ultime serait limité en l’absence de mesures provinciales équivalentes, sauf possiblement dans la capitale nationale. Les lieux de travail proprement fédéraux ou de compétence fédérale emploient une faible fraction de la population active. L’éducation et la langue de travail, les deux principaux secteurs d’intervention en matière de promotion du français, sont de compétence provinciale. Les autorités locales sont des « créatures des provinces ». La mise en œuvre effective des RFPF (ou tout autre nom qu’on veut leur donner) dépendra en fin de compte du bon vouloir des provinces. Le projet de loi C-13 va probablement aussi loin qu’il est politiquement envisageable de le faire, c’est-à-dire beaucoup plus loin que Trudeau père aurait pu l’imaginer ou même le souhaiter.
Le tableau n’est pas totalement sombre. Le français hors Québec ne va pas mourir. Il survivra et pourra même connaître un certain regain dans certaines collectivités rurales et petits centres urbains, simplement parce que ce sont des endroits qui reçoivent peu d’immigrants. Pour d’autres communautés minoritaires, notamment hors RFPF, le soutien continu du gouvernement fédéral aux institutions francophones assurera que le déclin se produira tranquillement, le français continuant parfois d’être transmis dans les foyers pendant plusieurs générations. Voilà un déclin bien canadien, très civilisé.
Dans un siècle, j’en suis convaincu, le français sera toujours la première langue à Caraquet dans la Péninsule acadienne comme dans d’autres collectivités linguistiquement en sécurité. Mais à cette date, ces vaillants francophones hors Québec ne compteront probablement plus que pour un ou deux pour cent de la population canadienne.
Ultime paradoxe, le défi de sauver le bilinguisme canadien reviendra alors presque exclusivement au Québec.
[1] Suite à la publication des données du recensement de 2021, une mise à jour de ce Repère est maintenant disponible en Annexe B. Les conclusions principales restent toutefois inchangées.
[2] L’« Attendu » pertinent est libellé comme suit : « le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais. »
[3] Voici le nouveau libellé (légèrement remanié) de la Section 3.1 : « a) les droits linguistiques doivent être interprétés de façon large et libérale en fonction de leur objet ; b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur ; c) l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits. »
[4] Pour un récent aperçu de la littérature universitaire sur la Loi sur les langues officielles, voir le numéro spécial de Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society : https://www.erudit.org/en/journals/minling/2021-n17-minling06632/.
[5] Canada, 1965. Rapport préliminaire de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, https://publications.gc.ca/site/eng/9.893456/publication.html .
[6] Léger, 2020. Sondage hebdomadaire de Léger, 29 juin, https://acs-metropolis.ca/wp-contentuploads/2020/06/Sondage-hebdomadaire-de-L%c3%a9ger-29-juin-2020.pdf.
[7] La loi a aussi échoué sur un autre plan : bâtir une nation bilingue dont les citoyens (à tout le moins beaucoup d’entre eux) comprennent les deux langues officielles : un idéal aussi noble qu’irréalisable. Environ 10 % des Canadiens hors Québec étaient bilingues en 2016, plus ou moins comme en 1969 : voir la figure 3A de l’annexe. Voir aussi Cardinal, L., 2004. « The Limits of Bilingualism in Canada », Nationalism and Ethnic Politics, vol. 10 no 1, p. 79-103.
[8] Sans faire les grands titres, l’Acadie française a aussi connu sa propre révolution sociale. En 1960, le Nouveau-Brunswick élisait ainsi pour la première fois un premier ministre acadien, Louis Robichaud.
[9] Pour un compte rendu personnel de la transformation sociale du Québec, voir Polèse, M., Le Miracle québécois, Éditions du Boréal, 2021.
[10] Ce terme désigne ici l’adoption d’une autre langue que sa langue maternelle comme langue parlée le plus souvent à la maison.
[11] À condition que le citoyen soit de langue maternelle française ou qu’il ait reçu une instruction primaire en français. Les conseils solaires français peuvent toutefois accepter les enfants d’immigrants francophones, cette question reste un objet de débat dont les solutions varient d’un endroit à l’autre.
[12] Environ 20 p. 100 des parents acadiens ne se prévaudraient pas du droit de faire instruire leurs enfants en français. Outre son incidence directe sur la transmission de la langue, ce choix a pour effet collatéral de réaffecter les efforts communautaires vers de coûteuses campagnes de marketing visant à convaincre les parents francophones de faire instruire leurs enfants en français. Source : Desjardins, Pierre-Marcel, Rapport portant sur les recommandations 1 et 2 du rapport du panel d’experts sur le financement de l’école francophone, Document soumis au Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACÉF), Moncton, 2012. https://www.aefnb.ca/wp-content/uploads/2015/10/Rapport-Pierre-Marcel-Desjardins-GACEF.pdf
[13] Le Québec en offre un bon exemple. Parmi les immigrants allophones de fraîche date (cohortes 2000-2010 et 2011-2016), respectivement 76,6 et 75,9 p. 100 ont adopté le français comme langue parlée à la maison, alors que 31,4 et 23,2 p. 100 ont adopté l’anglais, soit en proportions semblables à celles de la figure 3. Voir les tableau 10 et 26 de : Office québécois de la langue française, 2019. Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-linguistique.pdf.
[14] Voir le récent exemple de l’affaire opposant la Commission scolaire francophone du Yukon au territoire du Yukon (https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15357/index.do), dans laquelle le Québec a donné son appui au territoire en contestant la demande d’autonomie et de ressources accrues de la commission scolaire, de crainte de créer un précédent qui obligerait le Québec à offrir le même traitement aux écoles anglaises du Québec.
[15] La figure 3A, en annexe, illustre un autre aspect de la disparité croissante entre les deux univers linguistiques. De plus en plus de Québécois sont bilingues, contrairement au reste du pays, si bien qu’il ne serait pas totalement faux de prétendre, là encore sans fausse ironie, que la loi 101 a été plus efficace pour favoriser le bilinguisme que la Loi sur les langues officielles.
[16] Bordeleau, J. L., 2021. « Le patron d’Air Canada ne s’exprime qu’en anglais, le tollé est unanime », Le Devoir, 3 novembre, https://www.ledevoir.com/societe/645024/le-patron-d-air-canada-ne-s-exprime-qu-en-anglais-le-tolle-est-unanime.
[17] Signalons à la figure 7 le fléchissement de la courbe vers 1995, année généralement considérée comme celle des débuts de l’Internet.
[18] Office québécois de la langue française, 2019. Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, graphique 15, p. 55, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-linguistique.pdf.
[19] Le projet de loi C-13 énonce les lignes directives suivantes (extrait condensé) : « Lorsqu’il prend un règlement visant à définir les RFPF, le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment le nombre de francophones d’une région, la proportion de francophones ainsi que l’épanouissement et la spécificité de la collectivité. »
[20] Toutes les données sur les divisions de recensement et les zones urbaines sont tirées des tableaux de Statistique Canada (recensement de 2016) transmis à l’auteur.
[21] J’entends par « grandes universités » celles qui offrent à la fois des programmes de premier cycle et d’études supérieures. Il existe d’autres universités de langue française, mais l’éventail de leurs programmes est plus restreint.
[22] La RMR d’Ottawa-Gatineau n’y figure pas car elle chevauche le Québec et l’Ontario.
[23] Par définition, les villes sont des lieux de rencontre des cultures. Les couples mixtes dont l’un des membres est anglophone tendent à parler anglais à la maison, ce qui est l’un des principaux facteurs d’anglicisation dans les villes.
[24] Sur la nature périphérique des collectivités acadiennes, voir Desjardins, P.-M., 2005 « L’Acadie des Maritimes : en périphérie de la périphérie ? », Francophonies d’Amérique, no 19, printemps, p. 107-124, https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2005-n19-fa1813267/1005313ar/.
[25] J’imagine mal que les auteurs du projet de loi C-13 n’avaient pas connaissance de cette restriction. L’article 23 de la Charte est clairement incompatible avec ses objectifs, une contradiction qu’il faudra résoudre. Voir Polèse, M., 2022. « Minority Language rights: Charter’s Section 23 needs to be revised », Options politiques, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, 5 avril,
https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/april-2022/minority-language-rights-charter/.
[26] Pour une analyse de ces questions en termes de gouvernance, voir Cardinal, L., S. Lang et A. Sauvé, 2008. « Les minorités francophones hors Québec et la gouvernance des langues officielles : portrait et enjeux », Francophonies d’Amérique, no 26, automne, p. 209-233, https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2008-n26-fa3408/037982ar/.
[27] Voir les modifications sous « Langue de travail ». Je suppose que les mêmes dispositions s’appliquent aux travailleurs des institutions fédérales, y compris celles de l’administration publique, même si le projet de loi C-13 n’en fait pas mention.
[28] Office québécois de la langue française, 2019. Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, tableau 31, p. 86, https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2019/rapport-evolution-situation-linguistique.pdf.
[29] Le pourcentage des salariés du secteur privé serait sûrement moins élevé si l’on excluait les entreprises de compétence fédérale, tenues de se conformer à la loi 101.
[30] J’ai travaillé dans ces deux pays. Pendant l’un de mes séjours en Suisse, le canton de Zurich (germanophone) a ordonné à des parents francophones de fermer une école primaire privée qu’ils avaient fondée et financée. Les parents ont contesté cette injonction devant les tribunaux au motif qu’il s’agissait d’une école privée, mais ils ont été déboutés. Il n’était pas question d’autoriser ces parents à transporter leur droit à l’instruction en français dans le canton germanophone de Zurich.
[31] La Cour suprême a notamment confirmé la disposition limitant l’accès à l’école anglaise, bien qu’avec une dérogation.
[32] Les recommandations ci-dessous sont formulées sans égard à la possibilité que certaines puissent nécessiter une loi distincte, ce qui n’en modifie pas la teneur.
[33] Polèse, M., 2021. « Is modernizing the Official Languages Act a mission impossible? », Options politiques, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, 20 mai, https://policyoptions.irpp.org/magazinesmay-2021/is-modernizing-the-official-languages-act-a-mis-sion-impossible/.
[34] On a déjà enfreint le principe des « droits mobiles » dans le cas des Premières Nations.
[35] J’ai parfaitement conscience que cette recommandation mécontentera une partie de la minorité anglophone du Québec, notamment au sein du Quebec Community Groups Network. Mais il est temps d’en finir avec une fausse égalité qui oppose inutilement les francophones du Québec et du reste du pays.
[36] Le tableau 3A de l’annexe présente les 20 divisions de recensement du Québec comptant respectivement les ratios lpm/lm les plus faibles et les plus élevés pour l’anglais.
Annexe A — Autres Figures and Tableaux
Annexe B – Mise à jour suite à la publication des données linguistiques du recensement de 2021
Les résultats du recensement de 2021 ne changent pas la conclusion principale de l’étude. Le déclin du français au pays, surtout hors Québec, se poursuit. Le projet de loi C-13, malgré ses points positifs, ne sera pas suffisant pour arrêter ce déclin. Il faudra plus que des « mesures fortes », qui restent essentiellement incitatives, pour assurer la sécurité linguistique des communautés francophones hors Québec. En l’absence de mesures locales plus robustes en faveur du français, augmenter l’immigration francophone dans le reste du Canada ne sera qu’un secours passager face aux tendances lourdes qui continuent à favoriser l’anglais. La vraie solution ne réside pas tant dans l’accueil d’un plus grand nombre d’immigrants francophones, mais dans l’établissement de conditions locales qui permettront à leurs descendants de rester francophones. Seule une nouvelle vision du bilinguisme et du difficile arbitrage entre droits et sécurité linguistiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Québec, permettra de mettre en place ces conditions gagnantes.
Les principales figures de l’étude, mises à jour grâce aux nouvelles données de 2021, sont présentées dans les pages suivantes.
Voici quelques faits saillants à retenir du dernier recensement :
- La part des francophones au Canada (langue maternelle) est tombée en pas de la barre des 20 %. L’équilibre démographique entre les deux langues officielles est définitivement rompu.
- La différence entre le Québec et le reste du pays s’accentue. La part des Québécois ayant le français comme langue maternelle est certes en déclin, mais cette chute est compensée en partie par de nouveaux locuteurs qui adoptent le français comme langue parlée à la maison. L’inverse s’observe dans le reste du pays, où l’abandon du français est la règle. Cette tendance annonce des déclins futurs.
- L’abandon du français par les francophones hors Québec se poursuit, le taux d’abandon étant maintenant à 44 % en Ontario et à plus de 60 % dans les provinces de l’Ouest. Les francophones du Nouveau-Brunswick continuent à mieux résister, quoique même là la langue française perd toujours des locuteurs (une baisse de 11 points de pourcentage). Le Québec reste la seule province où le français attire de nouveaux locuteurs.
- À l’extérieur du Québec, les immigrants allophones adoptent massivement (presque à 100 %) l’anglais comme deuxième langue parlée à la maison. Même au Québec, l’attraction de l’anglais reste forte, puisqu’il est parlée à la maison par environ un tiers des allophones.
- Les deux minorités linguistiques du pays sont de plus en plus inégales. Le déclin des francophones hors Québec s’accélère, eux qui sont aujourd’hui à peine un demi-million à parler le français à la maison, tandis que les anglophones du Québec voient s’accroître leurs rangs pour s’approcher aujourd’hui d’un million.
- L’écart se creuse aussi en matière de bilinguisme entre le Québec et le reste du pays. Le Québec est de plus en plus bilingue, le reste du Canada de moins en moins. On peut y voir le reflet du déclin du français comme langue seconde (jugée) utile et de la suprématie toujours croissante de l’anglais comme langue la plus utile non seulement au Canada, mais un peu partout dans le monde.
À propos de ce Repère
Ce Repère a été publié en juin 2022 puis mis à jour en octobre 2022 suivant la parution des données du recensement de 2021. Cette mise à jour est disponible en Annexe B.
Cette étude fait partie du programme de recherche du Centre d’excellence sur la fédération canadienne, dirigé par Charles Breton. Le révision linguistique et la coordination éditoriale ont été effectuées par Étienne Tremblay, la correction d’épreuves par Paul Lafrance et la mise en pages par Chantal Létourneau et Anne Tremblay.
Ce document a été traduit de l’anglais par Michel Beauchamp et est aussi disponible sous le titre original : Amending the Official Languages Act: A New Vision of Bilingualism?
Mario Polèse est professeur émérite à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), à Montréal. Ses travaux portent sur l’économie urbaine et le développement régional. Il a récemment publié The Wealth and Poverty of Cities: Why Nations Matter (Oxford University Press) et Le miracle québécois (Boréal).
Pour citer ce document :
Polèse, Mario, 2022. La refonte de la Loi sur les langues officielles : une nouvelle vision du bilinguisme ?, Repères IRPP no 42, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques.
Remerciements
L’auteur souhaite remercier pour leurs conseils et commentaires Linda Cardinal de l’Université de l’Ontario français, Maurice Beaudin et Pierre-Marcel Desjardins de l’Université de Moncton, de même que Charles Breton et Rosanna Tamburri de l’IRPP.