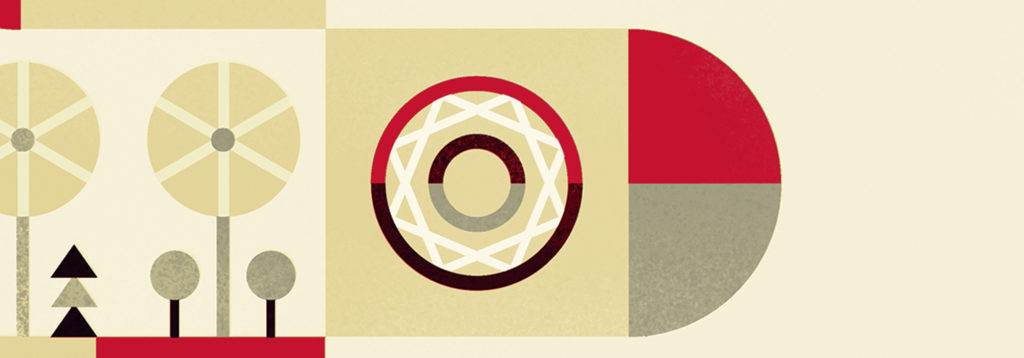La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : une tâche inachevée
Introduction
L’État-nation que nous appelons le Canada a été fondé sur le déni arbitraire et unilatéral du droit à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Selon la présomption coloniale en cours au XIXe siècle, les peuples autochtones devaient disparaître ou s’assimiler. Cela ne s’est pas produit. Mais en ce XXIe siècle, ils restent largement tributaires de cette vision archaïque. Du double point de vue étatique et individuel, le Canada et ses citoyens doivent réparer cette injustice pour assurer à la fédération un avenir vraiment prometteur. Ce qui nécessite de respecter les droits inhérents des peuples autochtones de façon beaucoup plus probante et transformatrice.
Des progrès ont été accomplis dans certains secteurs de l’autonomie gouvernementale. Mais dans la plupart des domaines de nos vies, nous restons assujettis aux décisions d’une classe politique, de bureaucrates et de juges qui comprennent ou reconnaissent difficilement nos lois, protocoles, traditions, valeurs et besoins[1]. Nos communautés en paient un lourd tribut. Ce prix est particulièrement élevé pour la jeunesse autochtone, qui se voit encore refuser la qualité de vie et les possibilités offertes à la majorité des jeunes Canadiens.
Nous avons vu à maintes reprises que le statu quo est source de désordre et de conflits. Il nous oblige par exemple à dresser des barricades ou à perturber l’économie pour défendre nos droits. Or l’État canadien ne peut prétendre à une pleine légitimité sans respecter ce que la Cour suprême a appelé la « souveraineté préexistante » des Premières Nations, des Inuits et des Métis[2].
L’immense majorité des Canadiens souhaitent un avenir fondé sur une véritable réconciliation avec les peuples autochtones, nous disent les sondages[3]. Mais qu’entend-on au juste par « réconciliation » ?
Le cadre d’une véritable réconciliation
La Commission de vérité et réconciliation du Canada a mené un examen exhaustif des crimes les plus atroces perpétrés en vertu des lois et politiques coloniales canadiennes. Son rapport de 2015 conclut à la possibilité d’une réconciliation si le pays accepte de transformer ses liens politiques, économiques et juridiques avec les peuples autochtones[4]. Et il rappelle l’existence d’un cadre pour mener à bien cette tâche qui s’étendra « sur plusieurs générations ».
Dans l’énoncé de son premier principe, la Commission précise ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) constitue le « cadre d’une réconciliation à tous les niveaux et secteurs de la société ». Adoptée en septembre 2007 par l’Assemblée générale des Nations Unies après plus de 20 ans d’intenses délibérations entre États et peuples autochtones, la Déclaration établit que ces derniers, à l’instar de toute nation, ont le droit inhérent à l’autodétermination. Elle récuse aussi expressément les doctrines de supériorité raciale invoquées pour justifier et masquer la négation de ce droit.
La Déclaration exhorte les États à collaborer avec les peuples autochtones à la réparation des graves préjudices causés par des politiques qui leur furent imposées pendant des générations, comme les pensionnats, et à éviter que de tels torts soient infligés à nouveau. Elle prévoit à cet effet une série d’obligations et de mesures de protection dans des domaines comme l’éducation, la gestion des terres, les services sociaux et le développement économique. L’ensemble de ces mesures et obligations forme un programme d’action nous permettant de regagner la maîtrise de nos vies et de notre avenir.
Des représentants autochtones ont consacré des décennies d’efforts acharnés à l’élaboration de cet instrument de défense des droits de la personne[5], délaissant leurs familles et leurs communautés pour faire valoir leurs droits dans les salles de réunion des Nations Unies. Ils ont consenti ces sacrifices pour que les normes définies dans le long préambule et les 46 articles de la Déclaration nous servent à rebâtir nos communautés tout en assurant à nos futures générations les moyens de s’épanouir en toute sécurité, sans renier leur culture ni leur identité.
Nos chefs et nos aînés savaient l’importance cruciale d’inscrire ces normes dans les droits internationaux de la personne pour pousser des États comme le Canada à collaborer enfin à l’instauration de changements pourtant urgents et fondamentaux.
Le processus de négociation et d’adoption a été ardu. Le Canada a joué un rôle clé pour rallier des appuis étatiques à la Déclaration, mais il a ensuite voté contre son adoption. En 2010, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a finalement appuyé le texte qu’il avait répudié, se disant « désormais convaincu que le Canada peut interpréter les principes de la Déclaration de façon conforme à sa Constitution et à son cadre juridique[6] ». En 2016, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a franchi un pas supplémentaire, annonçant que « le Canada appuie sans réserve la DNUDPA[7]. » Dans son discours du Trône de décembre 2019, il s’est engagé à « élaborer conjointement et déposer un projet de loi pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations nies sur les droits des peuples autochtones au cours de la première année du nouveau mandat[8] ».
Le Canada est aujourd’hui partie prenante d’un consensus mondial dont témoignent les résolutions adoptées à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies, selon lequel la Déclaration doit s’appliquer dans ses principes comme dans sa pratique. Sa mise en œuvre n’en demeure pas moins un défi de taille. La Commission de vérité et réconciliation en a fait le cadre d’une véritable réconciliation, mais l’épreuve décisive résidera dans ses mesures d’application : relèveront-elles d’une volonté concrète ou de vœux pieux ?
J’ai eu le privilège d’assister, fin 2019, à l’adoption par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique d’une loi sur la mise en œuvre de la Déclaration. De portée modeste, cette loi n’apporte aucun changement de fond à la législation ou aux politiques de la province. Elle prévoit simplement que la Colombie-Britannique et les peuples autochtones conçoivent ensemble un plan de mise en œuvre comportant de nouvelles lois et des réformes législatives que le Parlement examinera à une date ultérieure. Amorcé au début 2020, ce processus n’a toujours fait l’objet d’aucune précision[9].
Sans être une avancée majeure, la loi fut néanmoins perçue comme un rare et authentique geste de réconciliation. Ce qu’est venu souligner l’appui de tous les partis politiques de la législature, étayé par le vaste soutien des peuples autochtones et des leaders industriels[10].
Malheureusement, d’autres réactions suscitent moins d’optimisme.
La loi britanno-colombienne s’inspire du projet de loi d’initiative parlementaire C-262, présenté par le député néo-démocrate Romeo Saganash et adopté en 2018 à la Chambre des communes, dont on pouvait raisonnablement penser qu’il serait bientôt intégré au droit canadien[11].
De portée tout aussi modeste, ce projet de loi prévoyait simplement qu’Ottawa collabore avec les peuples autochtones à l’identification des lois et politiques à modifier et des mesures d’application à privilégier. À ce stade, on aurait pu l’intituler « Le moins qu’on puisse faire pour encore pouvoir prétendre appuyer la Déclaration de l’ONU ». Mais c’était déjà trop demander à certains. Une fois adopté, des députés conservateurs se sont félicités d’avoir voté contre en se topant dans la main. Le projet de loi est mort au feuilleton en juin 2019, victime des manœuvres dilatoires des conservateurs du Sénat, qui n’a donc pu procéder au vote final.
Les défenseurs du statu quo
Autodétermination, égalité de tous les peuples et individus, droit à l’éducation et à l’expression de sa culture et de ses traditions, droit de ne subir aucune discrimination ni assimilation forcée : tels sont les droits universels que la communauté internationale s’est engagée à respecter. Le mouvement de défense des droits des Autochtones est à l’avant-plan de plusieurs enjeux cruciaux qui agitent les démocraties libérales. Des enjeux qui concernent notamment la façon d’interpréter et d’appliquer les normes universelles relatives aux droits de la personne pour répondre aux besoins souvent collectifs des exclus et réparer les torts qu’ils ont subis.
Ce mouvement est à la fois conservateur et radical. Conservateur parce que sa revendication centrale appelle l’ensemble des pays à reconnaître au moins nominalement les droits des Autochtones. Radical parce que le seul fait de reconnaître que ces droits ont été bafoués et que les Autochtones méritent réparation met en cause la légitimité de démocraties libérales comme le Canada, pourtant reconnues pour respecter les droits de la personne et la règle de droit.
Inévitablement, l’application de la Déclaration de l’ONU se heurte ainsi au même racisme systémique qui a maintenu les peuples autochtones sous l’emprise de l’État canadien. Les privilégiés des sociétés coloniales dominent le discours public et peuvent déterminer selon leurs propres valeurs la gravité des problèmes et l’acceptabilité des solutions. Tout en niant l’urgence de combattre le racisme et la discrimination systémiques, politiciens et pontifes ont souvent instrumentalisé le racisme pour entraver les vastes changements réclamés par les peuples autochtones. Les exemples abondent. Pensons aux craintes qu’ils attisent en alléguant que les Autochtones veulent des « droits et des privilèges spéciaux » ou que « leurs demandes excessives ruineront le pays », alors qu’ils souhaitent simplement mettre fin aux politiques discriminatoires et obtenir les mêmes droits que tous les Canadiens.
Certains experts et politiciens, notamment en Colombie-Britannique, appuient la mise en œuvre de la Déclaration[12]. Mais d’autres s’y opposent en reprenant souvent ce scénario : reconnaissant d’abord les préjudices infligés aux Autochtones, ils disent ensuite soutenir les principes de la Déclaration, puis décrètent son application inutile. Après tout, arguent-ils, les droits des Autochtones sont déjà reconnus dans la Constitution, et leur application progresse au gré de la jurisprudence et des politiques gouvernementales. Certains ajoutent même qu’il serait dommageable d’appliquer la Déclaration, car on transgresserait ainsi l’équilibre des droits inscrits dans notre tradition juridique.
En dépit de sa tonalité progressiste — on reconnaît les injustices et le besoin de réconciliation —, cet argumentaire protège le statu quo de trois façons : on prétend avec condescendance mieux connaître les besoins des Autochtones qu’eux-mêmes ; on sous-estime clairement la gravité des préjudices qu’ils continuent de subir ; et on laisse entendre que leurs revendications sont excessives. Or, même à l’insu de ses défenseurs, ces raisonnements reposent sur des tropismes racistes.
Prenons le texte d’opinion paru dans le Financial Post pendant l’examen à la Chambre des communes du projet de loi fédéral sur la mise en œuvre de la Déclaration[13]. Ses auteurs, un éminent avocat d’entreprise et un ancien ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, parlent certes des « préjudices historiques » infligés aux Autochtones, mais affirment ensuite que l’évolution de la jurisprudence et des politiques canadiennes a « déjà largement contribué à réparer ces torts ». Si la Déclaration « regorge de messages d’espoir et de nobles aspirations », poursuivent-ils, sa mise en œuvre « anéantirait l’approche de réconciliation patiemment élaborée par nos tribunaux » et rendrait « impossible » tout équilibre des droits. À l’appui de cette étonnante allégation, ils soutiennent qu’elle « accorderait aux Canadiens autochtones des droits refusés à leurs compatriotes ». En guise d’exemple, ils citent les dispositions exigeant que les peuples autochtones consentent aux décisions touchant leurs propres terres.
La notion de « consentement » mérite ici quelques précisions. Elle est familière à tout citoyen ayant un jour signé un formulaire de consentement, selon un droit largement reconnu. Mais quand la Déclaration de l’ONU parle de droits territoriaux, elle désigne expressément des droits collectifs et non individuels. C’est-à-dire les droits qu’exercent les peuples autochtones par le biais de leurs propres gouvernements et des processus décisionnels issus de leurs traditions, comme le fait tout autre gouvernement en prenant des décisions collectives au nom de ses citoyens. Tous les Canadiens jouissent de ces mêmes droits par la voie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui ont le devoir de respecter leurs compétences mutuelles en vertu de la Constitution et de la common law.
De fait, les droits collectifs définis dans la Déclaration diffèrent fondamentalement des droits dont jouissent tous les Canadiens. Mais pourquoi serait-ce irrecevable en soi ? Déjà, notre tradition constitutionnelle, dont le texte d’opinion du Financial Times fait pourtant l’éloge, reconnaît les droits distincts des peuples autochtones. Les droits conférés par traité inscrits dans la Constitution varient pour les signataires autochtones et non autochtones. Et la Cour suprême a établi que nos droits ancestraux sont sui generis : collectifs et intergénérationnels, ils englobent des pouvoirs juridictionnels particuliers, différents des droits fonciers des autres Canadiens[14].
Et c’est justement la prise en compte de telles différences qui permet à une fédération de rassembler des peuples distincts. Notre tradition juridique établit tout aussi clairement qu’en présence de discrimination systémique et enracinée, l’application différenciée des droits est indispensable à une égalité réelle.
L’épreuve décisive de la mise en œuvre
Selon la Cour suprême, la nécessité de combler l’écart entre la « souveraineté préexistante » des Premières Nations, des Inuits et des Métis et la souveraineté « proclamée » de l’État canadien constitue un impératif constitutionnel. Au mieux, la réaction de la fédération à cet impératif s’est révélée anémique et fragmentaire. Certains peuples autochtones ont vu leurs droits notablement reconnus par des accords ou des décisions judiciaires, d’autres n’ont toujours aucun droit officiel sur les terres régies et exploitées par leurs ancêtres bien avant la fondation du Canada.
La Déclaration de l’ONU est réparatrice, car elle définit les mesures nécessaires pour remédier à des siècles de négation et de violation systématiques des droits fondamentaux des peuples autochtones. Mais elle est aussi prospective, car elle préconise la collaboration et le partenariat pour créer des liens équitables et harmonieux.
Certes, on soutiendra que nombre de ses dispositions ont déjà une incidence légale au pays. Selon une tradition juridique bien établie, le Canada interprète en effet ses obligations à la lumière des normes internationales en matière de droits de la personne. Il invoque déjà la Déclaration en ce sens, plusieurs tribunaux inférieurs, cours et organismes l’ayant citée dans leurs décisions. Et tout indique qu’il maintiendra cette approche, Ottawa l’ayant de nouveau invoquée dans sa récente Loi sur l’évaluation d’impact, qui fait explicitement mention de son engagement en faveur de la Déclaration de l’ONU[15].
C’est donc dire qu’une mise en œuvre partielle est en cours, ce qui influera forcément sur le cadre juridique de la fédération. Mais le fait de réserver aux seuls tribunaux l’interprétation et l’application des droits des Autochtones pose problème. Long et coûteux, le règlement de litiges impose un lourd fardeau aux peuples autochtones comme à l’ensemble du pays. Et les tribunaux ont clairement indiqué que les procédures contentieuses nuisent aux efforts de réconciliation.
Contrairement aux litiges réglés au cas par cas, les lois de mise en œuvre inspirées de celle de la Colombie-Britannique permettent une application beaucoup plus uniforme. Et je garde espoir qu’une telle loi sera adoptée au niveau fédéral. En définissant les processus de coopération entre les peuples autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, elle viendrait concrétiser le modèle de coopération et de partenariat préconisé par la Déclaration de l’ONU.
Sans assurer une pleine réconciliation, cette loi constituerait une étape préalable à l’application effective des obligations qui incombent au Canada en vertu de la Déclaration. Une étape attendue de longue date.
[1] L’auteure parle des peuples autochtones à la première personne car elle est une Anishinaabe de la bande Ojibwé du lac Supérieur.
[2] Voir, par exemple, Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 SCR, nº 1010, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1569/index.do.
[3] Reconciliation Canada, 2017. The Canadian Reconciliation Landscape: Current Perspectives of Indigenous Peoples and Non-Indigenous Canadians, North Vancouver, Reconciliation Canada, https://reconciliationcanada.ca/staging/wp-content/uploads/2017/05/NationalNarrativeReport-ReconciliationCanada-ReleasedMay2017_3.pdf.
[4] Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015. Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Winnipeg, Centre national pour la vérité et la réconciliation, Université du Manitoba, https://www.trc.ca/assets/pdf/French_Exec_Summary_web_revised.pdf.
[5] Lightfoot, S., 2016. Global Indigenous Politics: A Subtle Revolution, Abingdon, Routledge.
[6] Gouvernement du Canada, 2010. « Énoncé du Canada appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », Ottawa, Affaires autochtones et du Nord Canada, https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374239861/1309374546142.
[7] Gouvernement du Canada, « Le Canada appuie maintenant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones sans réserve », Ottawa, Affaires autochtones et du Nord Canada, 2016, https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtones-nord/nouvelles/2016/05/le-canada-appuie-maintenant-la-declaration-des-nations-unies-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-sans-reserve.html.
[8] Gouvernement du Canada, 2019. « Discours du trône », Ottawa, Bureau du Conseil privé, https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/discours-du-trone.html.
[9] Hudson, M., 2020. New Tools for Reconciliation: Legislation to Implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, https://irpp.org/fr/research-studies/new-tools-for-reconciliation-legislation-to-implement-the-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples/.
[10] Bill 41, Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, 2019. https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/41st-parliament/4th-session/bills/first-reading/gov41-1.
[11] Projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2018. https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-262/troisieme-lecture.
[12] Voir, par exemple, Papillon, M., et T. Rodon, 2017. Indigenous Consent and Natural Resource Extraction, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, https://irpp.org/fr/research-studies/insight-no16/.
[13] Swain, H., et J. Baillie, 2018. « The Trudeau government signs on to give Aboriginals veto rights nobody else has », Financial Post, 26 janvier, https://financialpost.com/opinion/the-trudeau-government-signs-on-to-give-aboriginals-veto-rights-nobody-else-has.
[14] Instauré par l’arrêt Guerin c. La Reine, 1984. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2495/index.do.
[15] Hudson, M., 2020. New Tools for Reconciliation: Legislation to Implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Cet essai fait partie de la série inaugurale d’essais du Centre d’excellence sur la fédération canadienne, sous la direction de Charles Breton. La coordination éditoriale a été effectuée par Étienne Tremblay et la mise en page par Chantal Létourneau et Anne Tremblay.
Cet essai a été traduit de l’anglais par Michel Beauchamp et est aussi disponible sous le titre original : Unfinished Business: Implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Canada. Le texte original a été révisé par Leslie Seidle, la révision linguistique a été effectuée par Madelaine Drohan et la correction d’épreuve par Zofia Laubitz. La révision et la correction d’épreuve de la traduction ont été effectuées par Étienne Tremblay.
Sheryl Lightfoot est titulaire d’une Chaire de recherche du Canada sur les droits et les politiques concernant les Autochtones du monde à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) où elle est professeure aux Départements de science politique et d’études autochtones ainsi qu’à la School of Public Policy and Global Affairs. Elle est également conseillère principale en affaires autochtones auprès du recteur de UBC. Ses recherches portent sur les politiques autochtones à travers le monde, plus précisément sur les droits des Autochtones et leur mise en œuvre. Sheryl Lightfoot est Anishinaabe de la bande Ojibwé du lac Supérieur.
Pour citer ce document :
Lightfoot, Sheryl, 2020. La mise en oeuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones : une tâche inachevée, Essai no 3, Montréal, Institut de recherche en politiques publiques.